Le Nirvana et le Samsara sont-ils une seule et même chose ? Huxley La philosophie éternelle
Que le Nirvana et le Samsara soient une seule et même chose, c’est là un fait touchant la nature de l’Univers ; c’est un fait dont ne peuvent se rendre compte pleinement et que ne peuvent éprouver par expérience directe que les âmes fort avancées en spiritualité. Que des gens ordinaires, convenables et non régénérés, acceptent cette vérité par ouï-dire, c’est simplement pour eux aller au devant d’un désastre…
La nature et la grâce, le Samsara et le Nirvana, la mort perpétuelle et l’éternité, ne sont réellement et par expérience une même chose, que pour les personnes qui ont rempli certaines conditions. Fac quod vis (fais ce que tu veux) dans le–monde temporel — mais seulement quand tu auras appris l’art infiniment difficile d’aimer Dieu de tout ton esprit et de tout ton cœur, et ton voisin comme toi-même.
Les évangiles sont parfaitement clairs quant au processus par lequel, et par lequel seul, quelqu’un peut gagner le droit de vivre dans le monde comme s’il y était chez lui : il faut qu’il fasse un renoncement total au moi, qu’il se soumette à une mortification complète et absolue.
Les pharisiens ont reproché à Jésus d’être venu en « mangeant et en buvant », et accompagné de « publicains et de pécheurs »; ils ont passé sous silence, ou n’ont pas connu, le fait que ce prophète apparemment séculier avait, à un certain moment, rivalisé d’austérités physiques avec saint Jean Baptiste, et pratiquait les mortifications spirituelles qu’il prêchait avec tant de cohérence.

Le modèle de la vie de Jésus ressemble essentiellement à celui du sage idéal, dont la carrière est exposée dans les « Images du Bouvier », si répandues parmi les bouddhistes zen.
Le bœuf sauvage, qui symbolise le moi non régénéré, est capturé; on l’oblige à changer de direction, on le dresse, et il est transformé peu à peu de noir en blanc. La régénération va si loin que, pendant un certain temps, le bœuf est complètement perdu, de sorte qu’il ne reste rien à représenter, que la lune: figurée pleine, symbolisant l’Esprit, la Réalité Telle, le Fondement. Mais ce n’est pas là le stade final. À la fin, le bouvier revient au monde des humains, monté sur le dos de son bœuf. Parce qu’il aime, à présent, qu’il aime au point d’être identifié à l’objet divin de son amour, il peut faire ce qu’il veut; car ce qu’il veut, c’est ce qui plaît à la Nature des Choses. On le trouve en compagnie de soiffards et de bouchers; eux et lui sont tous transformés en Bouddhas.
Pour lui, il y a conciliation complète avec l’évanescent, et par cette réconciliation, révélation de l’Éternel. Mais pour les gens ordinaires, convenables, non régénérés, la seule conciliation avec l’évanescent est celle des passions auxquelles on s’abandonne, des distractions auxquelles on se soumet, et qu’on goûte. Dire à de telles personnes que l’évanescent et l’éternel sont une seule et même chose, et ne pas immédiatement restreindre cette affirmation en la complétant, c’est véritablement d’une imprudence mortelle — car, en pratique, ce ne sont point une seule et même chose, sauf pour le saint; et l’histoire n’a pas gardé trace que quiconque soit jamais parvenu à la sainteté, qui ne se soit, au début de sa carrière, conduit comme si l’évanescent et l’éternité, la nature et la grâce étaient profondément différents et, par bien des côtés, incompatibles.
Le chemin de la spiritualité est une arête de couteau entre deux abîmes. D’un côté, il y a le danger du rejet et de l’évasion; de l’autre, le danger de la simple acceptation et de la jouissance de choses qui ne doivent être utilisées que comme des instruments ou des symboles.
La légende versifiée qui accompagne la
dernière des « Images du Bouvier » est la suivante : « Même au-delà de
la limite finale, s’étend un passage,
Par lequel il revient aux six royaumes de l’existence.
Chaque affaire séculière est maintenant une œuvre bouddhiste,
Et partout où il va, il retrouve l’air de chez lui.
Comme une pierre précieuse, il se distingue même parmi la boue,
Comme l’or pur, il brille même dans la fournaise.
Le long de la route sans fin (de la naissance et de la mort),
il s’avance, se suffisant à lui-même.
En toutes circonstances, il se déplace, tranquille et sans attache.
Il faut qu’il y ait conversion, soudaine ou non, non pas simplement du cœur, mais également des sens et de l’esprit qui perçoit. C’est dans les descriptions hindoues et extreme-orientales de la Philosophia Perennis que ce sujet est le plus systématiquement traité.
Ce qui est prescrit, c’est « une révulsion » plus ou moins soudaine et complète de la conscience, et la venue à la connaissance d’un état de « non-esprit » qu’on peut décrire comme la libération d’avec l’attachement perceptuel au principe du moi.
Pour y parvenir, il faut marcher délicatement et, pour s’y maintenir, il faut apprendre à unir la vigilance la plus intense à une passivité calme et négatrice du moi — la détermination la plus indomptable à une soumission parfaite aux directives de l’esprit.
« Si un œil ne s’endort jamais,
tous les rêves cesseront d’eux-mêmes ;
si l’Esprit garde son absolu,
les dix mille choses seront d’une seule substance. »
(le Troisième Patriarche du Zen)
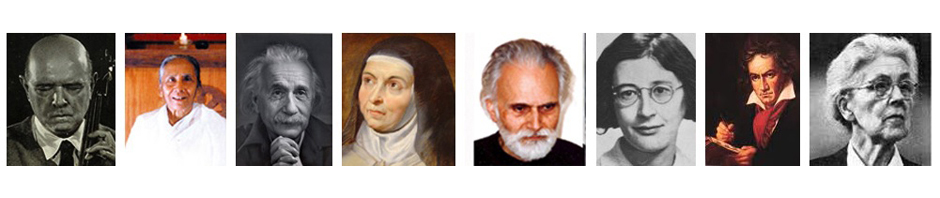
Laisser un commentaire